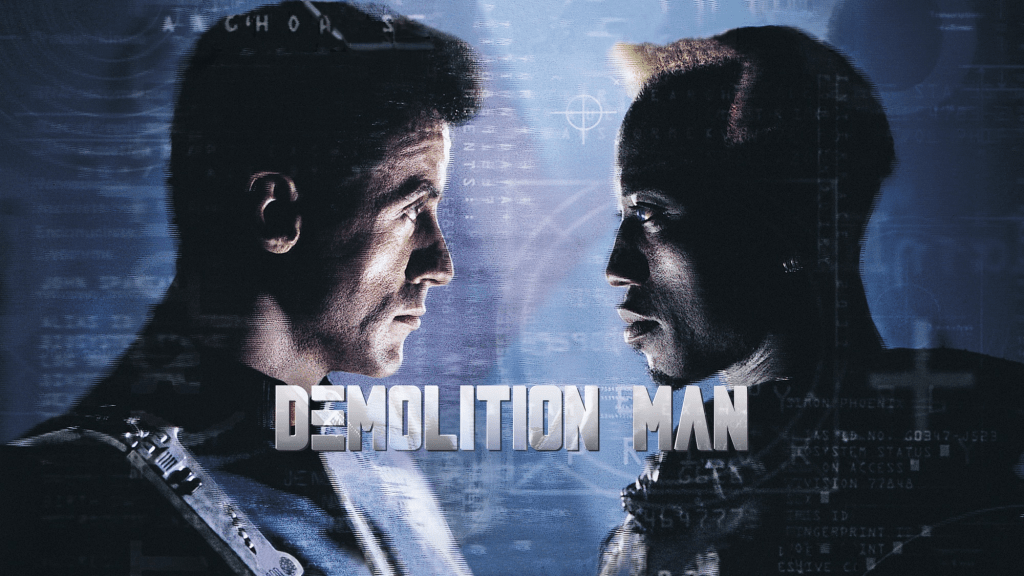
Sorti en 1993, Demolition Man est bien plus qu’un simple film d’action musclé. Sous ses dehors de blockbuster explosif, il cache une satire sociale acide, une réflexion sur les dérives du politiquement correct et une mise en scène futuriste qui n’a rien perdu de sa pertinence. Produit par Joel Silver, pape du cinéma d’action hollywoodien (on lui doit L’Arme Fatale et Predator), le film marque une étape singulière dans sa filmographie : celle d’un divertissement qui ose penser tout en cognant.
Le projet naît à la fin des années 80, dans l’esprit de Peter M. Lenkov, alors assistant de production. L’idée lui vient en écoutant en boucle la chanson Demolition Man de Sting, jouée par une boom box défectueuse. Ce détail, aussi trivial soit-il, donne le ton : le film sera punk, bruyant, et résolument provocateur. Plusieurs scénaristes se succèdent, dont Daniel Waters (Heathers) qui injecte une bonne dose d’ironie et de satire dans le script. Le résultat final est un mélange de Brave New World d’Aldous Huxley, de Running Man et de Robocop, avec une pincée de Sleeper de Woody Allen. Le choix du réalisateur, Marco Brambilla, est audacieux. Venu du monde de la publicité, il signe ici son premier long métrage. Son regard neuf donne au film une esthétique singulière, entre néons aseptisés et décors futuristes dignes d’un showroom Neiman Marcus. Ce n’est pas un hasard si le design de San Angeles, la ville utopique du futur, évoque autant les centres commerciaux que les laboratoires cliniques.
Dès les premières minutes, Brambilla impose un rythme effréné. L’ouverture, avec Los Angeles en flammes et Stallone héliporté dans un immeuble en ruine, est un modèle du genre. On pense à Die Hard, mais avec une surenchère visuelle assumée. Le montage de Stuart Baird (L’Arme Fatale 2, Casino Royale) est chirurgical : chaque scène d’action est découpée avec une précision qui rend les affrontements lisibles, nerveux et spectaculaires. La mise en scène alterne entre le chaos du passé et la froideur du futur. Ce contraste est renforcé par la photographie d’Alex Thomson (Legend, Excalibur), qui joue sur les teintes bleutées et les éclairages artificiels pour souligner l’aseptisation du monde de 2032. Le découpage visuel est pensé pour opposer deux mondes : celui de Spartan, brut et instinctif, et celui de Phoenix, anarchique et flamboyant.
Sylvester Stallone, dans le rôle de John Spartan, qui vient chasser sur les terres SF de son rival Arnold livre une performance étonnamment nuancée. Loin du monolithe de Rambo ou Cobra, il joue ici un flic dépassé par un monde qui ne comprend plus la violence. Son jeu, souvent moqué, trouve ici une justesse inattendue : il incarne la nostalgie d’un monde révolu, celui où l’on réglait les problèmes à coups de poing. Face à lui, Wesley Snipes est un feu d’artifice. Simon Phoenix est l’un des méchants les plus mémorables des années 90 sous l’influence du Joker de Jack Nicholson : blond peroxydé, look de skater punk, rictus permanent. Snipes s’amuse visiblement, et son énergie déborde de chaque plan. Il est l’incarnation du chaos, du refus des règles, et son interprétation est jubilatoire. On est loin du Snipes stoïque de Blade. Sandra Bullock, dans l’un de ses premiers rôles majeurs, apporte une touche de fraîcheur. Son personnage, Lenina Huxley, est à la fois candide et badass. Elle incarne la fascination pour le passé, et son duo avec Stallone fonctionne à merveille. Le reste du casting, de Nigel Hawthorne à Denis Leary, est solide, chacun apportant une couleur particulière à cet univers dystopique.
La musique d’Elliot Goldenthal (Alien 3, Heat) est une réussite. Elle mêle percussions industrielles, nappes synthétiques et envolées orchestrales pour créer une ambiance sonore à la fois futuriste et anxiogène. Le thème principal, nerveux et martial, accompagne les scènes d’action avec efficacité. Mention spéciale à l’utilisation de jingles publicitaires et de musiques kitsch dans les scènes du futur, qui renforcent le décalage comique.La chanson Demolition Man de Sting, reprise dans le générique, agit comme un clin d’œil ironique. Elle résume parfaitement le ton du film : provocateur, explosif, et un brin sarcastique.
Le design de San Angeles est l’un des points forts du film. David L. Snyder (Blade Runner) signe des décors qui évoquent à la fois l’utopie et la prison. Tout est propre, lisse, contrôlé. Les costumes, les véhicules, les interfaces numériques : tout respire la perfection artificielle. Ce monde sans aspérités est une critique directe de la société du confort, du politiquement correct et de la surveillance. Les détails absurdes – les trois coquillages, les amendes pour jurons, le sexe virtuel – sont autant de trouvailles qui rendent l’univers crédible et satirique. Le film ne se contente pas de montrer un futur dystopique : il le construit avec une cohérence qui force le respect.
Demolition Man a marqué son époque. Il a anticipé des débats qui sont aujourd’hui au cœur de nos sociétés : la surveillance, la censure, la sécurité sanitaire, la disparition du contact physique. Le film a prédit les voitures autonomes, les visioconférences, les assistants vocaux, et même l’ascension politique des célébrités (la bibliothèque Schwarzenegger n’est plus une blague). Son influence se retrouve dans des œuvres comme Equilibrium, Minority Report ou The Purge. Il a aussi inspiré des jeux vidéo, des séries, et reste une référence dans la pop culture. À sa sortie, le film a reçu un accueil mitigé. Certains critiques ont vu en lui un simple divertissement bourrin. Mais avec le recul, Demolition Man apparaît comme une œuvre plus riche qu’il n’y paraît. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est sa capacité à avoir anticipé les dérives d’un monde trop lisse, trop contrôlé. Le discours d’Edgar Friendly, qui revendique le droit de manger gras, de fumer, de penser librement, résonne comme un manifeste libertaire.
Conclusion : Demolition Man est un incontournable du cinéma d’action des années 90. Et si vous ne l’aimez pas, eh bien… je ne vous aime pas non plus !