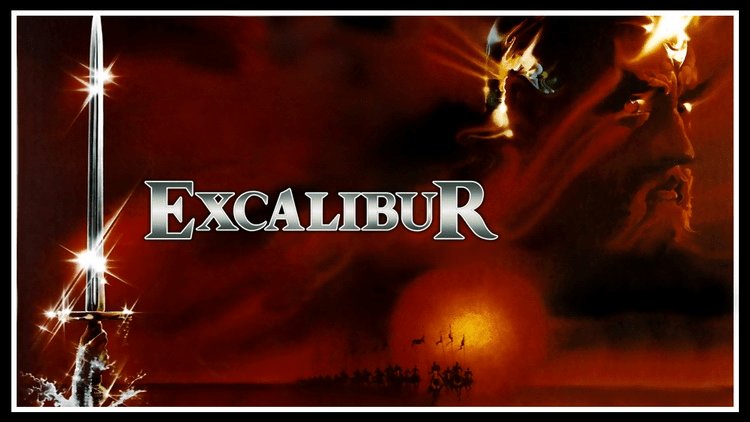
La première fois que j’ai vu Excalibur, j’étais enfant. Le souvenir est intact, presque sacré. Ce n’était pas un simple film : c’était une révélation. Une vision hallucinée du mythe arthurien, baignée de brume, de sang et de lumière. Quarante ans plus tard, cette expérience fondatrice reste gravée dans ma mémoire comme une initiation au pouvoir du cinéma. Excalibur ne raconte pas seulement une légende : il la fait vibrer dans chaque fibre de l’image.
John Boorman, auréolé du succès critique de Deliverance (1972), rêvait d’adapter Le Seigneur des Anneaux. Faute de droits, il s’est alors tourné vers une autre légende fondatrice de la culture occidentale : celle du roi Arthur. Boorman a choisi d’adapter la version de Thomas Malory, Le Morte d’Arthur, une source riche et foisonnante, mais aussi fragmentée et violente. Ce changement de cap donne naissance à un projet plus personnel, plus viscéral. Boorman ne cherche pas à illustrer une épopée : il veut la réinventer, la faire surgir comme une hallucination collective. Le film est conçu comme une fresque initiatique, une plongée dans l’inconscient collectif européen. Excalibur est un film qui puise ses influences dans un vaste champ d’expressions artistiques. Visuellement, il est une sorte d’hommage vivant aux illustrations médiévales et aux tapisseries de l’époque. Les couleurs vives, les formes stylisées des armures, les paysages brumeux évoquent les tableaux préraphaélites et l’art symboliste. C’est un film qui ne cherche pas le réalisme historique, mais le réalisme de la légende, de la légende telle qu’elle a été imaginée et transmise de génération en génération. L’œuvre de Boorman est aussi profondément influencée par les opéras de Richard Wagner, dont la musique est d’ailleurs utilisée de manière magistrale dans la bande-son. Le récit, avec ses amours impossibles, ses trahisons grandioses, ses duels épiques et son destin inéluctable, est bâti comme un opéra, avec ses grands airs et ses moments de recueillement. On y trouve également des échos du cinéma de Stanley Kubrick (2001, l’Odyssée de l’espace), notamment dans l’utilisation du symbolisme et d’une approche non linéaire de la narration. Boorman a également été influencé par la mythologie celtique et le symbolisme jungien, ce qui donne au film une profondeur psychologique rare pour un film de fantasy. Le scénario, coécrit avec Rospo Pallenberg (La Forêt d’émeraude), se concentre sur les grands thèmes universels du mythe : la naissance d’Arthur, la quête du Graal, la chute de Camelot et l’amour tragique de Lancelot et Guenièvre. Le film a été tourné entièrement en Irlande, terre natale de Boorman, dans des conditions difficiles et avec un budget relativement modeste pour l’ampleur du projet. Cette contrainte financière a poussé le réalisateur à faire preuve d’une grande créativité visuelle et à utiliser les paysages naturels pour donner une authenticité brute à son récit, ce qui a sans doute contribué à l’atmosphère si particulière du film.
Dans la carrière de Boorman, Excalibur occupe une place singulière. C’est son film le plus baroque, le plus mystique. Là où Zardoz (1974) explorait une dystopie futuriste, Excalibur revient aux racines du mythe. Il y a une continuité dans son obsession pour les figures messianiques, les mondes clos, les quêtes spirituelles. Plus tard, The Emerald Forest (1985) prolongera cette veine animiste, mais Excalibur reste son sommet visuel et narratif. La mise en scène de John Boorman est l’une des plus grandes forces d’Excalibur. Boorman filme comme un chaman : c’est un film qui se regarde comme un rêve éveillé, un tableau vivant, avec ses couleurs saturées, ses éclairages dramatiques et son utilisation magistrale de la fumée et du brouillard pour créer une atmosphère de mystère et de magie. Boorman utilise le ralenti de manière très efficace pour donner aux scènes de combat une dimension chorégraphiée et artistique, les transformant en ballets de violence. La caméra est souvent en mouvement, se déplaçant avec une grâce fluide à travers les paysages et les décors, épousant les mouvements des personnages et les émotions qui les habitent. Le réalisateur a un sens aigu du symbolisme, et il utilise la nature comme un miroir des âmes de ses personnages : la pureté de la forêt de Brocéliande, la boue et la brume de la guerre, le vert luxuriant qui renaît après la quête du Graal. Chaque plan est une image travaillée, une composition picturale qui contribue à la richesse visuelle du film. On a l’impression d’être plongé dans un univers parallèle, où la magie est aussi réelle que les rochers et les arbres.
La conception artistique d’Excalibur est d’une rare élégance. Elle ne cherche pas la vraisemblance historique, mais l’impact visuel, n’ayant pas peur d’afficher son côté fantastique, avec des armures de chevaliers conçues par Bob Ringwood (Batman, Dune) qui brillent comme des carapaces extraterrestres et des forêts qui semblent tout droit sorties d’un tableau de Gustav Klimt. Les décors sont simples, mais puissants, et ils servent à souligner l’aspect brut et sauvage de la légende. Le château de Camelot est une tour de pierre austère, le lac de l’épée est un lieu de mystère et de magie. Les costumes sont à la fois réalistes et symboliques, et ils évoluent avec les personnages, reflétant leur voyage intérieur. . Le vert brumeux des forêts irlandaises, les reflets chromés des chevaliers, les éclats de feu et de sang : tout concourt à créer une esthétique de l’excès. Le montage de John Merritt épouse la structure cyclique du récit. Le film est divisé en chapitres, comme un grimoire. Il y a des ellipses brutales, des transitions abruptes, des ruptures de ton. Cela peut dérouter, mais c’est cohérent avec la logique du mythe. Le temps n’est pas linéaire : il est rituel, initiatique. Le montage crée des résonances, des échos. La quête du Graal, par exemple, est traitée comme une dérive mystique, une plongée dans l’abîme.
Boorman a choisi de s’entourer d’acteurs de théâtre, pour la plupart inconnus à l’époque, pour donner un souffle de fraîcheur à la légende. Nigel Terry (Le Lion en Hiver, Le Masque de la mort rouge), dans le rôle du roi Arthur, incarne un personnage d’une grande humanité. Il est un jeune homme naïf et hésitant qui, par un coup du destin, se retrouve avec une épée dans les mains. On le voit grandir et mûrir sous nos yeux, passer de l’innocence à la sagesse, de la gloire à la tragédie. Sa performance est d’une grande subtilité et d’une grande force. Helen Mirren (The Queen, Gosford Park), dans le rôle de Morgane, est tout simplement éblouissante. Son personnage est un mélange de sensualité, de pouvoir, de jalousie et de rage. Elle est une femme complexe, qui est à la fois l’alliée et l’ennemie d’Arthur, et dont le destin est lié à celui de Camelot. Enfin, Nicol Williamson (La Rose et la Flèche, L’Avocat de la terreur), dans le rôle de Merlin, est l’âme du film. Il est un magicien à la fois comique et menaçant, un être mystérieux, mi-homme mi-faune, qui vit entre le monde des humains et le monde des esprits. Son jeu théâtral, ses monologues pleins de malice et sa présence charismatique font de lui un Merlin unique et inoubliable, une incarnation de la magie et de la sagesse.On notera également les apparitions de Liam Neeson (The Mission, Schindler’s List) et Patrick Stewart (Dune, Star Trek).
Le casting est un mélange fascinant de jeunes talents et de figures théâtrales. Nigel Terry, dans le rôle d’Arthur, incarne la fragilité du roi autant que sa grandeur. Nicol Williamson, en Merlin, est inoubliable : sarcastique, énigmatique, presque fou. Helen Mirren, en Morgane, brûle l’écran de sa sensualité vénéneuse. Nicholas Clay, Chérie Lunghi, Paul Geoffrey : tous apportent une intensité brute, une sincérité rare. Et que dire des ? Des promesses d’avenir, déjà éclatantes.La bande-son est une incantation. Trevor Jones compose des thèmes originaux, mais ce sont les emprunts à Wagner et Orff qui donnent au film sa puissance rituelle. O Fortuna, extrait de Carmina Burana, accompagne les scènes de bataille comme une litanie apocalyptique. La Marche funèbre de Siegfried, lors de la mort d’Arthur, est d’une beauté déchirante. La musique ne commente pas l’action : elle l’élève, la transcende. Elle fait du film une messe païenne.
La bande-son d’Excalibur est l’un des aspects les plus marquants du film. Boorman a fait le choix audacieux d’utiliser des pièces de musique classique, notamment de Richard Wagner et de Carl Orff, pour accompagner son récit. Le résultat est tout simplement magistral. La musique de Wagner, avec ses thèmes de la mort et de la gloire, accompagne les scènes de combat et les moments de grand drame. Le « O Fortuna » de Carl Orff, avec sa puissance chorale et son rythme martial, est utilisé de manière mémorable dans la scène d’ouverture, créant un sentiment d’épique et de destin inéluctable. C’est une bande-son qui n’est pas une simple illustration, mais une partie intégrante du film, qui donne une dimension lyrique et grandiose à l’histoire.
Excalibur est un film qui a trouvé sa place dans le genre en étant un film à part. Il ne ressemble à aucun autre film de fantasy de l’époque, et il est encore, quarante ans après sa sortie, une référence pour tous les amateurs du genre. Il est un film qui a osé explorer les aspects les plus sombres de la légende, et qui a su donner une nouvelle vie à un mythe éternel. Il est une œuvre de fantasy qui ne s’adresse pas seulement aux enfants, mais à un public adulte, qui explore les thèmes de la mort, du pouvoir, du sexe et de la trahison. Il est à la fois une fresque historique, un drame psychologique et un conte de fées sombre. Excalibur a laissé une empreinte profonde. Zack Snyder, dans Batman v Superman, cite explicitement le film : c’est le dernier que les Wayne voient avant leur mort. Le kryptonite-spear est une réminiscence d’Excalibur. Dans Rebel Moon, Snyder reprend la structure mythique, les figures archétypales. Mais au-delà des hommages, Excalibur a influencé tout un pan du cinéma fantasy. Sans lui pas de The Green Knight. Il a montré qu’on pouvait traiter la fantasy avec sérieux, avec audace, avec mysticisme.Certains le trouvent daté, kitsch, trop théâtral pour moi, c’est une œuvre totale, imparfaite mais nécessaire. Un film qui ose, qui brûle, qui marque.
Conclusion : Excalibur n’est pas un film à regarder : c’est un film à vivre. Il ne cherche pas à plaire, mais à envoûter. Il ne raconte pas une histoire : il invoque un mythe. Et dans cette invocation, il touche quelque chose de profond, de archaïque, de sacré. C’est pour cela que, quarante ans plus tard, je le revois comme si c’était hier. Parce que Excalibur n’est pas dans le passé : il est dans la mémoire, dans le rêve.