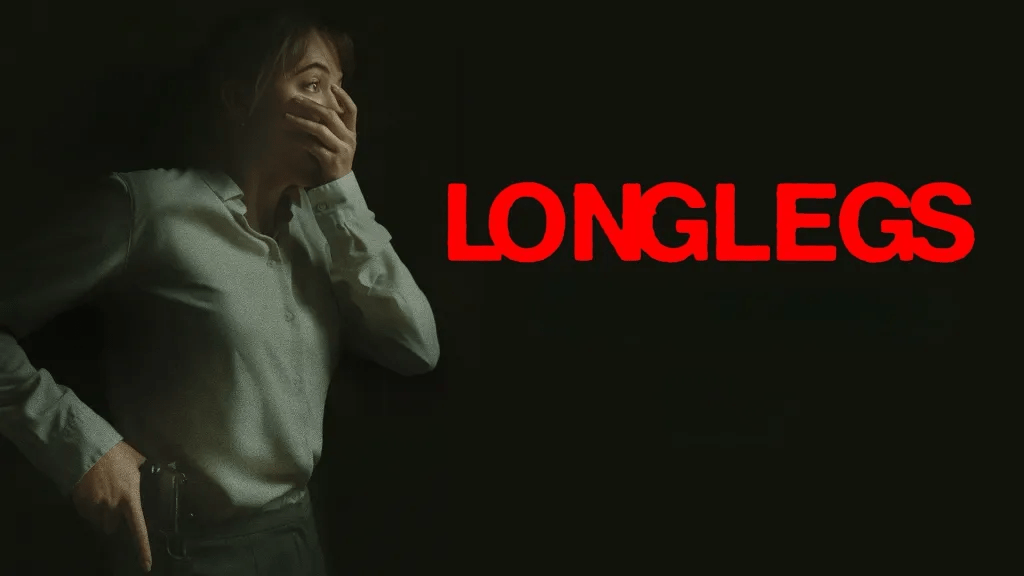
Longlegs est le type de série B qui faisait jadis le buzz dans les vidéo-clubs. Mais attention, cette production à 10 millions de dollars a pulvérisé tous les pronostics pour devenir le plus grand succès indépendant de l’horreur de la décennie, rapportant 127 millions de dollars dans le monde. La campagne marketing de Neon pour Longlegs restera dans les annales. Dépensant un montant élevé principalement en marketing digital, sans télévision, le studio a créé un buzz viral comparable à The Blair Witch Project ou Cloverfield. Des teasers cryptiques, un numéro de téléphone mystérieux (458.666.4355 pour appeler « l’homme d’en bas »), et surtout la dissimulation totale de l’apparence de Nicolas Cage jusqu’à la sortie du film ont créé une anticipation fébrile. Cette stratégie a transformé un film d’horreur indépendant avec un budget de 10 millions en phénomène culturel, rapportant plus de 74 millions de dollars en Amérique du Nord et devenant le film Neon le plus rentable de tous les temps, surpassant même Parasite oscarisé.
Le film est clairement influencé par Le Silence des Agneaux, Seven, Zodiac ou Héréditary, et surfe habilement sur les modes cinématographiques actuelles, ici l’elevated horror — un terme marketing autant qu’une catégorie esthétique. On y retrouve des figures connues : l’ancienne mégastar devenue l’empereur des films direct-to-video Nicolas Cage, la jeune vedette qui n’a jamais vraiment tenu les promesses de ses débuts mais qui reste un nom reconnaissable Maika Monroe, et des acteurs qui traînent leurs bosses de séries en films comme Blair Underwood ou la rousse Alicia Witt. Mais derrière la caméra se trouve un réalisateur qui sait créer une atmosphère oppressante et à qui on a donné les moyens de ses ambitions. Osgood Perkins ne réinvente pas la roue, ne prétend pas rivaliser avec la sophistication narrative de Fincher ou l’humanisme troublant de Jonathan Demme, mais il possède ce qui manque à tant de films d’horreur contemporains : un véritable sens du métier cinématographique. Le tournage a lieu de janvier à février 2023, principalement à Vancouver, avec un budget modeste mais stratégiquement alloué. Nicolas Cage, également coproducteur via sa société Saturn Films, s’engage dans le projet dès le début, fasciné par l’opportunité de créer un personnage radicalement différent de son registre habituel. Perkins a déclaré vouloir écrire et créer quelque chose pour attirer plus de regards, un film commercial qui ne sacrifierait pas pour autant sa vision artistique. L’inspiration est profondément personnelle : le réalisateur semble libérer ses propres démons intérieurs à travers le choix de son sujet, et il a même laissé entendre que la sombre histoire du mariage de ses parents y est pour quelque chose. Anthony Perkins était homosexuel et cachait son homosexualité à Berry Berenson, qui le dissimulait au public et à ses deux enfants. Perkins mourut en 1993 à l’âge de 60 ans des suites du sida, et Berenson périt dans le premier avion à percuter le World Trade Center en 2001. Si Longlegs, n’aborde aucun de ces sujets directement, certains de ses thèmes résonnent profondément en Osgood, qui ne se donne pas vraiment pour objectif de répandre l’espoir dans ses récits.
Dans Longlegs, Maika Monroe incarne l’agent du FBI Lee Harker. Cette dernière se plonge dans l’une des plus grandes affaires non résolues du bureau, une affaire qui a débuté dans l’Oregon dans les années 70 et se poursuit jusqu’à l’ère Clinton dans les années 90. Une série de dix meurtres familiaux étranges a déconcerté les enquêteurs. Ces affaires ont deux points communs : elles concernent toutes des jeunes filles nées le 14 du mois et, de façon troublante, le patriarche de la famille perd la raison, massacre sa famille et se suicide. Chacune de ces affaires non résolues recèle un indice, codé mais simplement signé par un certain Longlegs…Bien que Longlegs repose sur un mystère, Perkins semble bien plus soucieux d’instaurer une angoisse et une tension constantes que de concevoir une énigme complexe et labyrinthique à résoudre pour Harker (et le spectateur). L’horreur d’un film comme Zodiac réside dans l’impunité des crimes, et le suspense d’un film comme Le Silence des Agneaux tient au fait que nous savons que Buffalo Bill est le tueur, et que nous attendons impatiemment que Starling le rattrape avant qu’il ne soit trop tard. Longlegs ne fonctionne pas vraiment comme un polar classique. En ce sens, il est plus efficace comme film d’horreur, certes plus troublant que véritablement terrifiant. L’horreur peut assurément se trouver dans le culte satanique, et tous les tueurs en série n’ont pas besoin d’explications ni d’un passé. La fin de Longlegs est manifestement très personnelle pour Harker, mais le film est tellement axé sur la création d’une atmosphère angoissante que la plupart des personnages et de l’histoire restent des énigmes, des entités largement inconnues, laissées dans l’ambiguïté pour le spectateur. Le film s’inscrit dans une longue tradition de films évoquant la Satanic Panic, ce mouvement de panique morale qui a balayé l’Amérique du Nord dans les années 1980 et 1990. Cette période a été marquée par plus de 12 000 cas non fondés d’abus rituels sataniques, déclenchés par la publication en 1980 du livre Michelle Remembers, qui utilisait la thérapie par récupération de mémoire aujourd’hui discréditée. Films comme Rosemary’s Baby (1968), L’Exorciste (1973) et La Malédiction (1976) ont façonné l’imagination collective, préparant le terrain pour cette hystérie. Les accusations incluaient des théories du complot selon lesquelles des milliers de personnes étaient tuées chaque année par un réseau de satanistes infiltrant les médias, les forces de l’ordre, et même les crématoriums. La panique s’est nourrie de la peur des cultes religieux après les meurtres de Manson et le massacre de Jonestown, ainsi que de la montée du christianisme évangélique et de la Moral Majority. Longlegs fait écho à cette tradition cinématographique tout en l’actualisant pour notre époque.
La direction de la photographie d’Andrés Arochi, un cinéaste mexicain faisant ici ses débuts internationaux, est l’un des piliers du film. Contrairement à de nombreux réalisateurs qui créent des lookbooks détaillés, Perkins et Arochi ont préféré une approche intuitive, proches de celles de My Own Private Idaho, Drugstore Cowboy et Elephant de Gus Van Sant autant que des références évidentes comme Le Silence des Agneaux ou Seven. Le film mélange formats 35mm (tourné avec des optiques Cooke S4 en hommage à Harris Savides directeur de la photographie de The Game et Zodiac de David Fincher) et numériques créant une texture visuelle riche et stratifiée. L’utilisation délibérée de ratios d’aspect changeants est particulièrement saisissante : les scènes de flashback sont filmées en 4:3 claustrophobique aux coins arrondis, évoquant de vieux films de famille, tandis que l’enquête des années 90 se déploie en format large 2.39:1. Arochi explique avoir voulu laisser de l’espace vide dans le cadre pour que la peur vivent derrière le dos du spectateur. Cette approche se traduit par des cadres décentrés, des angles impossibles, des conversations où les regards des personnages ne se rencontrent jamais vraiment. Chaque élément visuel dévie subtilement des conventions cinématographiques, créant un monde légèrement désaxé qui met le spectateur mal à l’aise sans qu’il puisse toujours identifier pourquoi. La palette de couleurs oscille entre des tons sépia dorés cliniques rappelant l’univers de David Fincher et des contrastes violents entre ombres profondes et point de lumière crue. Le blanc et le rouge sont utilisés avec parcimonie mais impact.Le montage de Graham Fortin et Greg Ng privilégie la tenue de plans longs et statiques, avec des mouvements latéraux occasionnels ou des zooms rampants d’une lenteur terrifiante. Cette approche crée une attente angoissée : le spectateur attend en redoutant qu’une horreur surgisse dans le cadre. Lorsque la caméra se met enfin en mouvement, suivant généralement Harker, on sait instinctivement que le danger approche. Perkins emploie également des coupes brutales et des flashs subliminaux, mais ces techniques ne semblent jamais gratuites. Le premier acte fonctionne comme un film contemplatif, privilégiant l’atmosphère sur l’action, avant que le récit ne s’accélère progressivement vers son climax déstabilisant. La musique, composée par Zilgi (pseudonyme d’Elvis Perkins, le frère du réalisateur et musicien folk-rock) , crée un paysage sonore aussi oppressant que les images. Utilisant des synthétiseurs sombres et menaçants, des instruments déformés et des éléments de design sonore subliminal, Zilgi a construit une partition qui fonctionne presque comme un personnage à part entière. En collaboration étroite avec le sound designer Eugenio Battaglia dont le travail est presque aussi essentiel que la photographie, la bande sonore mélange paysages sonores électroniques et rock dissonant pour créer un « portail vers l’enfer » selon les propres termes des créateurs. Battaglia a utilisé des techniques innovantes, notamment en enregistrant des parties de la musique puis en les inversant complètement, de sorte que le public entende la partition à l’envers sans s’en rendre compte (clin d’œil aux rumeurs de messages sataniques soit disant cachés dans des disques de rock si on les écoutaient à l’envers). L’utilisation de chansons de T. Rex (notamment « Get It On », « Jewel » et « Planet Queen ») apporte une dimension glam rock décalée qui contraste brillamment avec l’horreur. Perkins a découvert le groupe en regardant le documentaire Apple TV 1971: The Year That Music Changed Everything pendant l’écriture du scénario. Avec ses cheveux filasses et son allure négligée, Cage ressemble même à Marc Bolan, le chanteur de T. Rex décédé dans un accident de voiture.
Nic Cage fait un de ses numéros les plus audacieux, caché sous un maquillage épais qui transforme complètement son apparence, avec de longs cheveux filasses et une voix geignarde et stridente qui monte très haut de façon agaçante (une idée de Cage lui-même). Le maquillage de Harlow MacFarlane est si efficace que Cage devient méconnaissable. Ici en revanche pas d’histoire psychologique à la Norman Bates : Longlegs ‘est un malade mental qui crée des poupées de porcelaine à l’effigie de ses victimes et les laisse comme indices, c’est une création unidimensionnelle d’un sataniste devenu fou, mais que Cage, avec son style inimitable, transforme en œuvre d’art. Je ne peux m’empêcher de penser que ce fan absolu de comic-books ne se soit pas inspiré du Joker pour construire sa performance. Certes ce n’est pas Hannibal Lecter, mais entre les mains de Cage, Longlegs est indéniablement hilarant et terrifiant à la fois. C’est un acteur qui vaut toujours le détour. Monroe, quant à elle, est beaucoup plus réaliste et prend son travail très au sérieux, surtout quand tout cela commence à la toucher de très près. Lee Harker est un mélange entre l’agent Starling et Lisbeth Salander. Perkins et Arochi ont développé un langage visuel spécifique pour elle, elle bouge à peine, reste presque figée et se tient toujours un peu plus loin des gens que la normale. Il lui a donc donné des objectifs plus larges, l’abstrayant visuellement même quand elle est entourée de monde. Monroe s’investit pleinement dans le rôle et est excellente, même dans le dernier acte, où tout s’effondre sous le poids d’un rebondissement scénaristique tellement excessif, avec ses problèmes de crédibilité surnaturelle et ses changements de personnages, qu’il manque de peu de détruire l’atmosphère que Perkins avait voulu créer.
Longlegs s’inscrit dans le mouvement dit de l’elevated horror ou post-horror, aux côtés de films comme Héréditary, Midsommar, The Witch ou It Follows (avec Monroe également). Ces films privilégient l’atmosphère, les thèmes psychologiques profonds et l’esthétique artistique aux jump scares faciles. Mais soyons honnêtes : là où Ari Aster ou Robert Eggers construisent de véritables œuvres d’auteur avec des ambitions thématiques complexes, Longlegs reste avant tout un film d’exploitation qui utilise les codes de l’elevated horror comme vernis de respectabilité. C’est précisément ce qui rend le film fascinant. Perkins n’essaie pas de dissimuler ses emprunts — il les exhibe presque avec fierté. Le profiler du FBI aux capacités intuitives ? Le Silence des Agneaux . L’enquête obsessionnelle sur un tueur en série insaisissable ? Seven et Zodiac. Les éléments surnaturels qui contaminent le polar ? Héréditary. Le réalisateur a même admis avoir voulu mélanger tous les clichés du genre : massacre à la hache, tueurs en série, le diable, des poupées, des granges sombres… la liste est longue. Longlegs est fondamentalement, le Den of Thieves de l’elevated horror : une série B d’exploitation qui surfe consciemment sur la vague du genre, pillant sans complexe Le Silence des Agneaux et l’univers de Fincher sans prétendre à leur ambition artistique ou à leur profondeur thématique. Mais là où d’autres films se seraient contentés d’être des copies serviles, Longlegs bénéficie d’un soin artisanal et d’un talent de réalisation qui transcendent ses origines opportunistes. Mais voilà le tour de force : au lieu de s’effondrer sous le poids de ses références, Longlegs les digère et les transforme en quelque chose qui fonctionne. Comme Den of Thieves empruntait sans vergogne à Michael Mann tout en offrant un spectacle viscéral et haletant, Longlegs pille ses modèles prestigieux tout en créant une expérience horrifique marquante. Ce n’est pas du grand art, mais c’est du grand artisanat — et dans le cinéma de genre, cette distinction compte moins qu’on ne le pense. Comme le film de Christian Gudegast avec ses braquages, Perkins transforme ses emprunts éhontés en quelque chose de viscéralement divertissant et durablement marquant, prouvant qu’un film peut assumer son statut de produit d’exploitation tout en s’élevant grâce au métier et à la vision de ses créateurs. L’atmosphère pesante que Perkins sait indéniablement créer reste la force majeure du film. Longlegs ne cherche jamais à rivaliser intellectuellement avec les œuvres qui l’inspirent — il n’a ni la sophistication psychologique du Silence des Agneaux, ni la rigueur formelle obsessionnelle de Zodiac, ni la résonance émotionnelle dévastatrice d’Héréditary. Mais il possède quelque chose que beaucoup de ces imitateurs oublient : un véritable savoir-faire technique et une compréhension viscérale de ce qui rend l’horreur efficace au cinéma. Avec Longlegs, Perkins frôle la réussite, créant un film qui satisfera surtout les fans prêts à l’accompagner dans ces méandres obscurs sans exiger la rigueur narrative de ses modèles. Heureusement, ses défauts ne sont pas rédhibitoires, et ses qualités formelles suffisent à compenser une intrigue qui, scrutée de trop près, révèle ses coutures. Certains y ont vu le film d’horreur de l’année, d’autres une coquille vide privilégiant le style sur la substance. La vérité se situe probablement entre les deux.
Conclusion : Longlegs est un film imparfait mais fascinant, une série B consciente de son statut qui s’élève par la grâce du talent de ses artisans. Ce n’est pas un chef-d’œuvre qui redéfinira le genre, mais c’est un divertissement solidement construit qui confirme Osgood Perkins comme un réalisateur capable de transformer des matériaux dérivés en expérience cinématographique mémorable. Dans un paysage horrifique saturé de copies paresseuses et de remakes sans âme, c’est déjà une victoire considérable. C’est une œuvre qui hante longtemps après le visionnage, comme un cauchemar à moitié oublié qui continue de vous poursuivre en plein jour — même si vous vous rappelez avoir déjà rêvé quelque chose de similaire ailleurs.