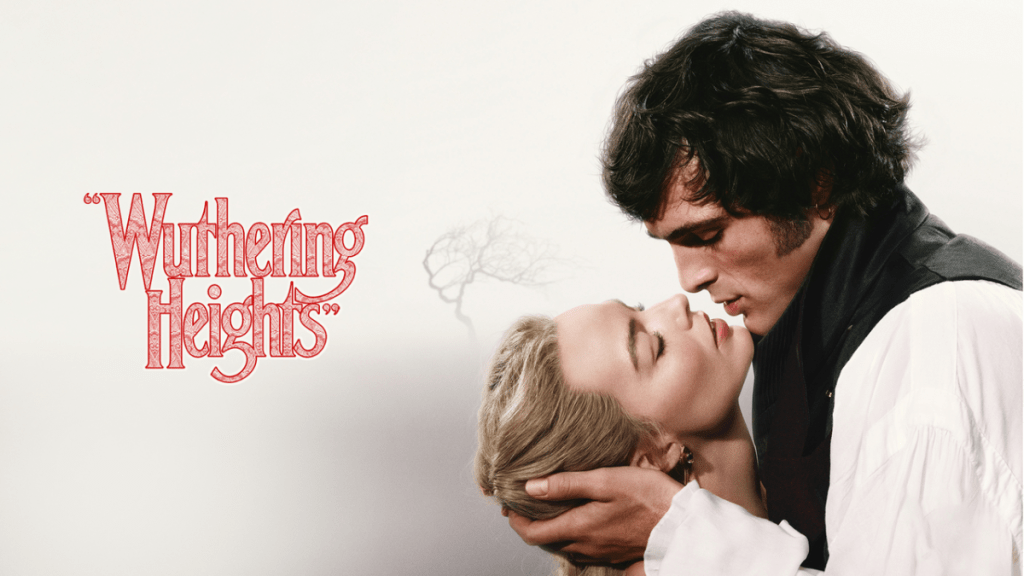
Tout commence en juillet 2024, lorsqu’Emerald Fennell annonce qu’elle écrira et réalisera une adaptation du roman d’Emily Brontë inspirée par le succès des drames en costume réinventés à la Bridgerton ou The Favourite, Fennell a pitché une version « viscérale et sexy » des hauts de Hurlevent. L’affaire est vite scellée : Margot Robbie, dont la société de production LuckyChap Entertainment co-produit déjà les deux premiers films de Fennell, rejoint le projet en tant que Catherine Earnshaw et productrice, tandis que Jacob Elordi (Frankenstein) est confirmé dans le rôle de Heathcliff, sans même passer d’audition. Warner Bros. remporte finalement une âpre guerre des droits face à Netflix, en offrant 80 millions de dollars mais en garantissant la sortie en salles et une campagne marketing ambitieuse, conditions non négociables pour Fennell et Robbie. L’origine du projet est franchement avouée : Fennell a lu le roman comme une adolescente amoureuse de l’amour fou, et c’est précisément cette lecture-là qu’elle filme. Pour se préparer, elle a reparcouru une liste de films qu’elle appelle ses « love stories » de chevet : Random Harvest (1942), A Matter of Life and Death (1946), Peau d’âne (1970), Bram Stoker’s Dracula (1992), Crash (1996), Romeo + Juliet de Baz Luhrmann (1996) ou encore Portier de nuit (1974). Le film se veut ainsi moins une adaptation fidèle qu’un aveu personnel, et Fennell le revendique avec un geste stylistique fort : les guillemets qui encadrent le titre dans l’affiche officielle, signalant d’emblée qu’il ne s’agit pas du roman de Brontë, mais d’une version — sa version.
La liste d’influences de Fennell dit beaucoup sur ce qu’elle cherchait à faire : une œuvre hyperstylisée, anachronique par principe, qui assume le kitsch et l’excès comme outils de la passion. Le problème, c’est que là où Baz Luhrmann parvenait dans Romeo + Juliet à transformer l’anachronisme en énergie cinétique pure, Fennell semble l’utiliser davantage comme un vernis décoratif. Le résultat oscille sans cesse entre le chef-d’œuvre ornemental et la publicité de parfum de luxe. On retrouve aussi l’influence de Sofia Coppola (Marie Antoinette, Lost in Translation) dans ce rapport à la sensualité féminine contrainte et à l’ennui doré, et même, étonnamment, un écho au Robert Eggers de The Witch dans le traitement des landes comme espace hostile et chargé de maléfices. Mais là où ces cinéastes savent ménager le vide et le silence, Fennell sature chaque plan jusqu’à l’excès. Son film ne respire jamais tout à fait.
Le film s’ouvre sur un plan audacieux : des bruits qui évoquent le plaisir érotique se révèlent être ceux d’un pendu se débattant sur un gibet, sous le regard fasciné de Cathy et de la foule. C’est une déclaration d’intention — Fennell annonce qu’ici, Éros et Thanatos sont indissociables. La promesse est forte. Malheureusement, le film qui suit ne l’honore qu’à moitié. Techniquement, Fennell déploie un arsenal impressionnant. Elle travaille à gros traits expressifs : des gros plans obsessionnels sur les textures (cicatrices dans un dos, lacets d’un corset, larmes sur une joue), des compositions symétriques qui rappellent le tableau vivant plus que le cinéma de genre. Mais la narration visuelle, si elle impressionne par sa maîtrise formelle, finit par se refermer sur elle-même. Chaque scène est si consciemment designée, si manifestement « vue », qu’elle peine à émouvoir. C’est là le paradoxe central du film : ce Wuthering Heights aspire à la fièvre et se présente comme un objet froid. La narration visuelle de Fennell abandonne le naturalisme pour la stylisation à outrance avec des ralentis excessif , chaque rencontre entre Catherine et Heathcliff est traitée comme une publicité pour un parfum de luxe, des changements de format, le film alterne entre un format large épique et un format carré (1:33) pour symboliser l’enfermement psychologique des personnages, une technique déjà vue mais ici poussée à l’extrême.
Margot Robbie est Catherine Earnshaw. Elle est convoquée ici comme icône autant que comme actrice, et sa présence à l’écran est indéniable. Robbie joue Cathy comme une force de la nature, cruelle et magnifique, incapable de la moindre demi-mesure. Sa performance est physique, totale, elle apporte une énergie nerveuse, presque maniaque, à Catherine mais semble trop souvent puiser dans son interprétation d’Harley Quinn pour tenter de convoquer quelque chose de l’impulsion adolescente, de la sauvagerie pré-sociale du personnage que son âge (Robbie a 36 ans) même si elle est superbe évidemment lui échappe inévitablement. Jacob Elordi, lui, fait le travail par présence pure. Grand, ténébreux, il incarne un Heathcliff plus mélancolique que vengeur. C’est là que le film rend le moins justice au roman : le casting d’Elordi, séduisant mais fondamentalement « blanc », évacue la dimension raciale et sociale du personnage de Brontë — un outsider dont la couleur de peau et les origines obscures structurent toute la violence de classe qui traverse l’œuvre. Ce Heathcliff-là est un beau ténébreux, pas un paria. Ce n’est pas la même chose. Curieusement, le couple fonctionne mieux quand il est séparé que réuni. Dès qu’ils occupent le même espace, quelque chose se grippe : la chimie tant annoncée vire à la démonstration. Parmi les seconds rôles, Hong Chau (Nelly Dean), Martin Clunes (Mr. Earnshaw, magistral dans son alcoolisme brutal), Alison Oliver campe une Isabella Linton convaincante, obsédée par Roméo et Juliette, dont la trajectoire sert de contrepoint ironique au destin de Cathy. et la révélation Owen Cooper, découvert dans la série Adolescence, dans le rôle du jeune Heathcliff, tirent remarquablement leur épingle du jeu. Ce n’est pas un hasard si le film se termine sur les personnages dans leur enfance tant on ressent plus d’émotion pour eux que pour leur version adulte.
C’est sans doute le terrain de sa conception artistique que le film est le plus indiscutablement réussi — et paradoxalement le plus problématique. Le film puise moins dans le cinéma de patrimoine britannique que dans le baroque de Baz Luhrmann pour le montage frénétique et l’opulence, le Giallo italien pour l’utilisation de couleurs primaires saturées (le rouge sang des landes) et les clips vidéo et la photographie de mode des années 90 notamment le travail de Herb Ritts pour cette lumière « papier glacé ». Linus Sandgren (La La Land, Saltburn) offre une photographie somptueuse : les landes du Yorkshire filmées en format large, les ciels rouge sang, les intérieurs oppressants de Wuthering Heights jonchés de bouteilles vides, contrastant avec la serre lumineuse et dorée de Thrushcross Grange. La production designer Suzie Davies imagine des espaces qui ne sont pas réalistes mais qui reflète les émotions des personnages : un manoir qui semble engloutir ses habitants, une chambre aux murs pailletés qui désarçonne et fascine à la fois. Mais ces décors aux allures de set de shooting pour Vogue avec leur palette de bleus électriques et de pourpres profonds qui cherchent à rendre le récit universel finissent par rompre le contrat d’immersion. La costumière Jacqueline Durran (double oscarisée pour Anna Karénine et Barbie) élabore pour Cathy une garde-robe de plus de cinquante tenues qui font consciemment référence au cinéma hollywoodien de l’âge d’or — Merle Oberon dans l’adaptation Wyler de 1939, Vivien Leigh dans Gone with the Wind — plutôt qu’à la réalité historique. Mais le rouge omniprésent, utilisé comme motif récurrent de la passion et du danger, finit par être si littéral, si insistant, qu’il en perd sa force.
Le film dure 136 minutes, et cette durée se fait sentir. Le rythme est heurté, irrégulier, jamais vraiment maîtrisé. Le montage est saccadé, empêchant toute scène de « respirer ». On passe d’un moment de tension à une ellipse de plusieurs années en un clin d’œil, ce qui désamorce la montée de la tragédie. Les scènes s’étirent au-delà de leur point d’équilibre naturel — comme si Fennell ne faisait pas confiance au spectateur pour tenir l’implication, pour rester dans l’ellipse. Le résultat est une accumulation de moments forts qui, à force d’insistance, s’annulent mutuellement. La première moitié du film est nettement plus réussie . La montée de tension entre Cathy et Heathcliff, leur enfance partagée puis leur séparation progressive, sont racontées avec une vraie urgence. Mais la seconde partie — qui correspond à peu près au moment où Cathy choisit d’épouser Edgar — perd en cohérence narrative. Le score d’Anthony Willis — déjà collaborateur de Fennell sur Saltburn et Promising Young Woman — est ample, douloureux, tendu comme un arc. Il porte la narration quand l’image se perd dans sa propre splendeur. L’apport de Charli XCX, est plus discret qu’attendu — loin des ruptures anachroniques de Marie Antoinette de Coppola oui des films de Luhrmann— mais House, qui ouvre le film avec la voix parlée du vétéran John Cale sur des cordes industrielles, pose une atmosphère immédiate et inoubliable. Chains of Love, qui accompagne un montage post-mariage de Cathy, touche juste et révèle ce que le film aurait pu être s’il avait su maintenir ce niveau d’accord entre image et musique.
Je n’ai pas vu Saltburn, mais Promising Young Woman m’avait profondément touchée par sa manière de tenir ensemble la forme — acidulée, presque pop — et une violence narrative qui ne lâchait rien. Cette Wuthering Heights m’a donc d’autant plus déçu. Ce n’est pas que Fennell ne sait pas filmer — chaque plan prouve le contraire. C’est qu’elle semble ici ne plus savoir pourquoi elle filme. La forme s’est émancipée du fond. Entre l’esthétique de pub de parfum de luxe et le sous-Baz Luhrmann — la fureur sans l’électricité, le baroque sans la syncope — le film rate le coche. Ce que Luhrmann réussissait avec Romeo + Juliet, c’était de faire de l’anachronisme un choc électrique, de transformer la distance ironique en immersion totale. Fennell, elle, utilise les mêmes outils (la référence cinéphile revendiquée, la bande-son contemporaine, les costumes ostensiblement « faux ») sans jamais produire le même courant. On regarde avec une admiration froide là où on devrait regarder avec la gorge serrée. L’autre problème fondamental est celui de l’attachement aux personnages. Cathy et Heathcliff sont présents visuellement dans chaque plan, mais absents émotionnellement dans leur rapport mutuel. On ne s’attache pas à eux — et c’est une mort pour un mélodrame. Sans cet investissement, les scènes d’intensité érotique sonnent creux, le dénouement tragique ne déchire rien.
Conclusion : Si j’avais été transporté par l’audace et la noirceur de Promising Young Woman, je reste ici sur le bord de la route. Le film souffre d’un syndrome de l’esthétique pub de parfum . Chaque plan est beau, certes, mais d’une beauté vide. En voulant singer le style flamboyant d’un Baz Luhrmann, Fennell oublie ce qui fait la force du réalisateur de Moulin Rouge : le cœur. Ici, l’émotion est sacrifiée sur l’autel du style. Il est terriblement difficile de s’attacher à ces personnages. Catherine et Heathcliff sont ici des icônes de mode qui se font la tête, plutôt que deux âmes damnées liées par une passion destructrice. Ce manque d’ancrage émotionnel désamorce totalement le mélodrame. On regarde le film comme on feuillette un magazine de décoration : c’est joli, c’est lisse, mais ça ne nous raconte rien sur la douleur humaine. En résumé, ce Wuthering Heights version 2026 est une coquille vide. Une œuvre qui se regarde se regarder.